05 nov. 2021Le fabuleux destin d'Adolf El Assal

L’American dream luxembourgeois
Avant les grosses productions qu’il développe aujourd’hui, Adolf El Assal fait ses armes à la réalisation de Divizionz, puis Reste bien mec ! il y a quelques douze ans. Deux films tournés sans budget, sans scénario, avec les moyens du bord, dans une idée de production cinématographique low-cost dans laquelle El Assal se retrouve encore, même si ses ambitions se sont démultipliées. Si Adolf El Assal vient de ce genre de films dit « guérilla », tourné avec rien ou presque, son modèle se fonde sur celui de l’industrie américaine du cinéma dans une dynamique de création qu’il compare à celle du collectif Kourtrajmé, pour des films infusés de son parcours de vie, pour le moins rocambolesque. En 2018 il tourne son second long-métrage Sawah, premier volet d’un triptyque aux lignes autobiographiques. Et le film exulte instantanément à sa sortie, d’abord dans une avant-première au Luxembourg City Film Festival en 2019 et juste après en Chine au Beijing International Film Festival, pour connaitre une année de succès, voyageant dans une quarantaine de pays dans les salles obscures d’une centaine de festivals pour y remporter une trentaine de prix. Derrière la reconnaissance de ses paires, le luxembourgeois reçoit une volée de propositions, embarqué en tant que réalisateur sur la poilante série belge Baraki et en tant que producteur du film de noël The Beanie dirigé par Slobodan Maksimović au documentaire Absolutely Must Go de Jean-Noël Pierre. Entre-autres films et projets, Adolf El Assal fait partie du collectif luxembourgeois de l’Exposition Universelle de Dubaï, une marque honorifique pour l’artiste, arrivé par « hasard » au Luxembourg avec sa famille il y a des années. Mais le hasard existe-t-il vraiment ?
À notre dernière rencontre, en 2018, vous tourniez les premières images de votre dernier long métrage Sawah, nominé par six fois au Lëtzebuerger Filmpräis 2021. Entre temps, on a pu vous voir évoluer considérablement, en tant que cinéaste autour de votre travail de producteur, réalisateur et scénariste. Depuis le succès de Sawah, qu’est ce qui a changé dans votre vie ?
J’ai été ravi des résultats et qu’un film luxembourgeois puisse voyager autant. Quand la Covid est arrivée, le film devait sortir en France dans 200 salles, mais malheureusement ça a été annulé. Ça a été une grande déception. Mais Netflix est venu vers moi et ils m’ont fait une belle offre pour diffuser le film sur 46 pays. Ça m’a rendu vraiment heureux, d’autant que c’était la première fois que Netflix travaillait avec une production luxembourgeoise. En mai 2020, Sawah est donc sorti sur Netflix. Néanmoins, comme les droits appartiennent à un distributeur français, il n’a pas pu être hébergé sur la plateforme française. Et de fait, nous ne l’avons que peu montré en France. Jusqu’aujourd’hui, il a été montré au festival de Fameck, où il a gagné le prix du public, et en avant-première à l’Institut du Monde Arabe à Paris. C’est dommage de ne pas avoir pu trouver le public français, d’autant que le film a été numéro un pendant une semaine dans une trentaine de pays sur Netflix et dans le monde arabe il a été dans le top 10 pendant huit semaines… Tout cela m’a vraiment ouvert des portes. Sawah a été vendu à l’une des majors aux États-Unis. Il n’est pas sorti en salle à cause de la Covid encore une fois, mais ils l’ont publié en DVD et Blueray pour le diffuser dans 5 000 Walmart à travers le pays. Et en quelques semaines ils ont vendu quasiment la totalité des copies. Je ne connais pas les chiffres exacts mais c’est autour d’une centaine de milliers de copies. Et, enfin, il y’a quelques semaines, Sawah est sorti dans les salles en Corée du Sud, numéro 3 du top 10 au box-office en une semaine, devant deux autres superproductions sud-coréennes. Personnellement je ne sais pas trop quoi penser de tout ça en tant que luxembourgeois, après la pandémie qui a mis à mal l’industrie cinématographique. J’ai su y tirer mon épingle et si je n’ai pas pu voyager avec mon film il a fait le tour du monde. Je reçois tous les jours des messages du monde entier, ça me touche beaucoup, parce que pour faire ce film j’ai vraiment tout sacrifié, j’ai galéré, je n’avais plus d’argent pendant le tournage, j’ai même fait une demande de RMG… On me prenait à l’époque pour un réalisateur fantasque, j’ai pris les risques sur moi et je suis allé jusqu’au bout… Aujourd’hui, je pense avoir prouvé que quand on croit vraiment en un projet, on peut réussir.

Sawah © Wady Films-Deal Productions
Grâce à Sawah, Nabil Ben Yadir, l’une des personnes les plus influentes dans le cinéma belge, vous a approché pour vous confier la réalisation de certains épisodes de la première saison de la série Baraki, créée par Julien Vargas et Peter Ninane. Série un brin déjanté et surtout très drôle mettant au cœur du récit ceux qu’on appelle en Belgique les Barakis. Quelle a été la genèse de votre travail sur ce programme ?
Nabil avait vu Sawah et il a beaucoup aimé. Il m’a appelé pour me féliciter et m’a proposé de réaliser une série dont il est le producteur. On a commencé à bosser sur Baraki juste avant le confinement. C’était un peu un rêve pour moi de faire ce genre de choses, la façon dont c’est écrit, le format… J’ai tout de suite dit oui. Malheureusement, le premier jour du tournage, c’était aussi le premier jour du confinement. Tout a donc été annulé. Cinq mois plus tard, début août, on a pu commencer à travailler. On était l’une des premières productions à se remettre au travail en Europe. J’étais le premier des quatre réalisateurs à travailler sur ce projet, j’avais donc beaucoup de pression dans le sens où je devais créer le look de la série, la mise en scène, trouver des affinités avec les scénaristes, les acteurs et toute l’équipe. Malgré tout, je me sentais assez confiant, vu mon expérience dans la réalisation de films sans budget, sans matos… C’est principalement le rythme qui m’a effrayé, comme c’est une comédie ça peu vite tomber à plat. J’ai eu quelques hésitations dans ce sens-là, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien et quand la série est sortie sur Tipik, une chaine de la RTBFon découvrait des chiffres incroyables d’audience en Belgique de semaine en semaine, ce qui m’a rendu très fier. Et là on prépare le tournage de la deuxième saison…

Baraki © 1080 Films-KALC-RTBF
Sans transition, en 2015, vous fondez Wady Films que vous tenez avec le directeur photo Nikos Welter et le scénariste Sirvan Marogy. Porté ces dernières années par les films à succès Sawah et My Grandpa is an Alien, votre boite de production s’est considérablement développée et compte aujourd’hui cinq films en production et neuf en développement, dont trois pour lesquels vous tiendrez la réalisation. Vous pouvez nous raconter cette incroyable expansion de votre activité cinématographique ?
J’ai en effet créé Wady Films pour porter mes projets, et notamment en Sawah. C’était compliqué au début mais quand Sawah est sorti j’ai tout d’un coup eu bonne réputation dans l’industrie. On a trouvé la confiance du Film Fund, qui n’est pas du tout évidente à avoir. En six ans seulement, je crois qu’on a constitué un catalogue assez solide. Ça me donne de la confiance et de la fierté, parce que si je remonte en arrière, beaucoup me disait que c’était du suicide de monter une telle boite au Luxembourg. Mais ça ne m’a jamais fait peur. Dans mon parcours j’ai toujours fait beaucoup de choses par moi-même. Et au final, quelques années plus tard, j’ai cinq employés à plein temps qui travaillent pour moi, un superbe bureau à Differdange, on reçoit des projets de très grande qualité, du monde entier, de certains réalisateurs oscarisés ou palmés… Cette année par exemple, on a dû refuser des projets par manque de moyens humains et logistiques. Étrangement, le confinement nous a un peu poussé d’une façon ou d’une autre ; là où la plupart des gens ont galéré ça a été complètement le contraire chez nous. Notre collaboration avec Netflix a évidemment été un catalyseur pour nous comme pour la visibilité du cinéma luxembourgeois à l’international et bien entendu ensuite encore plus avec la série Capitani. Wady Films est devenu un acteur majeur sur le marché local et international. Je peux vous dire déjà que 2022 va être vraiment incroyable. On prévoit de sortir un film quasiment tous les deux mois et pour tous les goûts : des films pour enfants comme des films intimes, dramatiques, des comédies, des documentaires…

Wady Films © Marion Dessard-1535
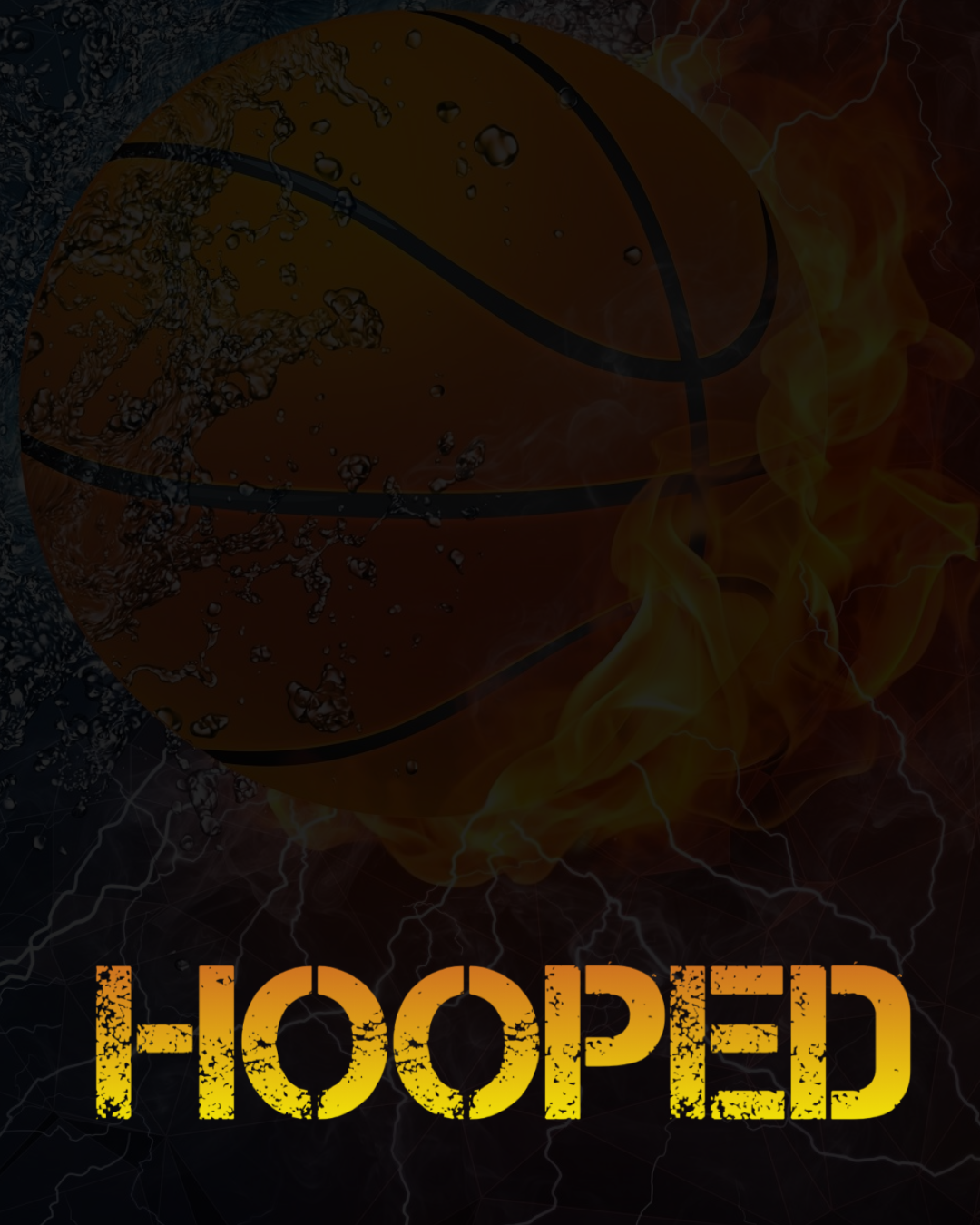
Hooped © Wady Films
Votre carrière a commencé avec Divizionz et Reste bien mec !, deux films du cinéma dit « guérilla », avec peu d’argent, une petite équipe et un équipement léger... Au-delà des grosses productions que vous pouvez monter dorénavant, qu’avez-vous conservé de cet esprit « guérilla » à la base de votre patte cinématographique ?
C’est mon école. Même si je sors d’une école de cinéma, personnellement j’ai remarqué assez tôt qu’on en arriverait à une démocratisation totale de la production des films. Aujourd’hui, tu peux tourner un film avec un IPhone. Ce défi qu’on s’est donné en 2006 avec mes amis, je savais que ça allait devenir le futur, que la vidéo allait devenir très accessible. C’est grâce à cet état d’esprit que j’ai trouvé cette force et cette confiance pour aller de l’avant et me développer. Je ne peux pas dire que mes premiers films étaient des bons films techniquement, je les ai faits comme un exercice, pour voir jusqu’où on peut aller avec la technologie d’une époque. J’adore les réalisateurs comme Werner Herzog ou Cassavetes qui sont des gars qui ont commencé par faire des films incroyables avec deux fois rien. Le cinéma encore aujourd’hui est un milieu très fermé. Il faut faire partie d’une certaine élite, de génération en génération. Je n’ai pas eu cette chance, mais le cinéma m’a fasciné dès le départ et m’a fait tel que je suis aujourd’hui. C’est grâce au cinéma que je suis devenu plus adulte, que j’ai appris à lire, que j’ai ouvert les yeux par rapport à beaucoup de choses et aujourd’hui je sais faire un film du début à la fin, en prenant part à toutes les étapes. Ça me permet de garder le contrôle sur ce que je fais et peu de gens peuvent me mettre des bâtons dans les roues. Ce chemin a été très dur et c’est ça aussi ce que j’essaye de transmettre à des jeunes réalisateurs qui démarrent avec les moyens du bord. Aujourd’hui, n’importe qui peut faire un film, raconter une histoire et la mettre en scène d’une certaine façon pour pourquoi pas lancer une carrière.
Les Quickies, une initiative que vous avez lancée pendant la pandémie avec le réalisateur Govinda Van Maele, suit un peu cette vision, donnant la possibilité à 18 cinéastes, de tous bords, confirmés ou non, de produire un film diffusé ensuite sur la plateforme dédiée et sur RTL. En quoi ce genre de projet vous tient particulièrement à cœur ?
C’était un peu un rêve pour moi parce qu’il faut avouer qu’au Luxembourg personne ne prend de risques. Les gens disent qu’ils ne reçoivent pas assez d’argent, malgré les 150 000 euros qu’on peut trouver ici pour faire un court-métrage. Les trois quarts des films personne ne les voit, les réalisateurs sont déprimés parce qu’ils n’ont pas fait le film qu’ils voulaient faire ou que les retours sont mauvais et on dit que c’est de l’argent jeté par les fenêtres… J’ai été heureux de me lancer dans un projet avec Govinda, que je respecte beaucoup. On est deux gars avec des noms bizarres, issus de l’immigration et qui font des films qui s’exportent… Ensemble, on s’est rendu compte que nous étions plus fort. Pendant le confinement, on était chacun très frustrés, on voulait continuer à travailler, même de chez nous. Par hasard je suis tombé sur le projet Homemade qu’a développé Netflix en invitant des réalisateurs reconnus dans le monde à libérer leur créativité pendant le confinement dans des courts-métrages. On s’est dit qu’on pourrait faire ça au Luxembourg. On a déposé un dossier au Film Fund qui nous a octroyé 60 000 euros pour la réalisation de dix petits films. On a reçu trente-cinq propositions et de dix films on est passés à dix-huit en réduisant le budget alloué à 2 020 euros comme un symbole. Quand on voit la qualité des choses et les retours qu’on reçoit c’est une grande réussite. Les gens voient la qualité des films, des histoires qui fonctionnent, ils ne regardent pas le budget. C’est du jamais vu chez nous, au Luxembourg. Avec Govinda, qui tout comme moi a commencé de rien, on a montré aux gens qu’on peut faire des films de qualité sans grand budget.

Adolf El Assal © Pauline Miller
Vous avez en effet brisé un système établi par une certaine génération à l’époque. Vous êtes un peu cette nouvelle génération de cinéaste qui tient les rênes du cinéma luxembourgeois…
Avant nous, il y a une ancienne génération de réalisateurs qui se comptent sur les doigts d’une main et maintenant il y a encore une autre génération qui se lance. Ça me réjouit vraiment que quelque chose de nouveau soit en train de se créer au niveau local et qui se développe sur la scène internationale. Avec les Quickies on voulait vraiment montrer aux gens que ce n’est pas que l’argent qui fait un bon film, c’est aussi et surtout la passion et le talent avec lesquels certains peuvent aller quelque part. Je viens d’avoir un mail de RTL, ils vont commencer à diffuser deux courts-métrage par semaine jusqu’à la fin de l’année. C’est incroyable d’avoir un tel partenaire local pour toucher un public plus large. C’est une vraie opportunité d’être diffusé par une chaîne qui n’a jamais diffusé de courts-métrage jusqu’alors. C’est du « made in Luxembourg », local pour un public luxembourgeois ou plus pour certains films qui sont déjà accueilli par des festivals à l’international.
À l’image des Quickies, dans les objectifs affirmés de Wady Films et dans tes affections propres, il y a aussi cette volonté de soutenir la jeune génération de cinéastes et de leur donner les moyens de développer leurs idées. À l’image de collectifs comme Kourtrajmé, y a-t-il cette envie de créer une vraie écurie de cinéastes hébergés chez Wady Films ?
Kourtrajmé pour moi c’est une vraie référence. Je connais bien leur travail. J’ai suivi Romain Gavras sur son documentaire sur DJ Mehdi et TTC. Ça a été l’une de mes premières inspirations. Et dans la même idée, j’aimerais créer un collectif où tout le monde s’entraide. Ça a toujours été mon rêve de faire un truc du genre au Luxembourg. Avec Wady même si c’est une boîte commerciale, ce qui me tient à cœur c’est vraiment de pouvoir rassembler de jeunes réalisateurs, ou techniciens, pour leur donner leur chance. Même si je suis ultra sélectif et que je ne laisse pas tout le monde entrer dans ce club. Je reçois beaucoup de projets, parfois certains sortent du lot. Mais ce qui m’intéresse le plus c’est d’où viennent ces jeunes. J’aime écouter leurs histoires personnelles car pour moi un réalisateur ce n’est pas quelqu’un qui est juste technique, c’est quelqu’un qui a un vécu. J’essaie un peu de leur donner ce que je n’ai pas eu. Comme un papa. C’est dans ma nature de grand-frère de partager mon savoir. Jeune, si j’avais eu le soutien d’un producteur ou d’un réalisateur ma carrière serait peut-être ailleurs aujourd’hui. Malheureusement ça n’a pas été le cas et j’ai dû me battre pour arriver là où je suis. Alors, on forme les jeunes qui font partie de Wady, ils apprennent sur le terrain et poursuivre leurs propres projets. L’idéal pour moi serait un jour de créer une école de formation cinématographique comme Kourtrajmé l’a fait.

Wady Films © Marion Dessard-1535
En parallèle à votre frénésie filmique, vous faites partie du collectif de huit artistes qui occupe le pavillon luxembourgeois de l’Expo 2020 Dubaï. Le Luxembourg vous a donné carte blanche dans ce pays que vous décrivez comme votre « seconde patrie ». Basé sur une idée qui vous est chère, à savoir l’identité luxembourgeoise, comment s’est goupillé votre association avec Julie Conrad (design), Guy Helminger (littérature), Karolina Markiewicz & Pascal Piron (arts visuels), Simone Mousset (danse), Patrick Muller (musique) et Renelde Pierlot (théâtre) ?
Ça fait quelques années qu’on développe cet immense projet avec le collectif. Depuis 2017/2018. Chaque artiste travaille dans une direction très différente. Dans mon cas j’ai beaucoup travaillé avec le duo Karolina Markiewicz et Pascal Piron sur leur projet cinématographique expérimental qui parle notamment de l’identité. Personnellement, j’ai envoyé mon court-métrage réalisé dans le cadre des Quickies, parce qu’il y avait une vraie corrélation entre la thématique de l’exposition et mon travail sur ce film. C’était assez parfait de voir à quel point mes idées et envies critiques croisent ces thématiques. Full Memory sera donc présenté dans le pavillon et est en même temps déjà en visionnage live sur Internet comme pour faire écho à tout ça à 6 500 kilomètres de là…

Full Memory © Wady Films
25 millions de visiteurs sont attendus aux Émirats arabes unis pendant six mois. Et certains d’entre eux viendront jusqu’au 31 mars 2022 pour découvrir le projet collectif que vous déclinez depuis 2017. Et ce projet, basé sur la formule luxembourgeoise « Mir wëlle bleiwe wat mir sinn » – « Nous voulons rester ce que nous sommes » –, concrètement est-il aussi timide qu’on l’entend ?
On a beaucoup travaillé au Luxembourg, avec entre-temps un voyage à Dubaï, il y a deux ans. J’en avais profité pour revoir mes contacts et mettre les autres artistes en relation avec des personnes sur place. Je suis bien ancré là-bas pour y avoir travaillé longtemps. J’ai des contacts très fort jusqu’au niveau diplomatique et culturel depuis ces années à voyager entre Luxembourg et Dubaï. J’y ai construit un solide carnet d’adresses que j’ai pu partager avec les autres artistes impliqués dans le pavillon. J’avais aussi envie de leur montrer une autre image de Dubaï. Tout le monde a le cliché en tête mais quand on était là-bas on ne reconnait rien de ce cliché. Les artistes qui m’accompagnaient n’ont en effet rien compris à ce qu’ils voyaient là-bas. Ils ont vu des choses complètement contraires à ce qu’ils pensaient. On a par exemple visité une exposition qui montrait de la nudité, des thèmes critiques, etc. Les artistes du collectif ont finalement changé de point de vue sur ce pays. De fait on a été critiqués par rapport à notre investissement sur cette exposition universelle. Comme quoi ça aurait été l’occasion d’avoir un discours critique sur ce qui se passe là-bas en termes de droits de l’Homme. Mais c’est ce qu’on a fait en partie. La plupart des gens n’ont rien vu de ce qu’on a fait là-bas et pense que nous n’évoquons pas les problématiques qui existe à Dubaï. En tant qu’artiste notre but n’est pas de changer le monde, mais de mettre un point sur les choses. Mon film par exemple est extrêmement critique par rapport au monde arabe et également par rapport à ici, allez le voir et vous comprendrez.
Les plus populaires
- 20 juil. 2023
- 04 avr. 2024
- 27 mar. 2024
- 26 mar. 2024
ARTICLES
Articles
26 avr. 2024Sebastian Thiltges
Videos
26 avr. 2024TAPAGE avec Alexandra Uppman, Govinda Van Maele et Daniel Migliosi
Articles
25 avr. 2024

