21 oct. 2021De quelques formes actuelles de l’économie des arts 2/4

Marché de rareté et spéculation financière
Parmi les marchés artistiques c’est en général celui des arts autographiques qui retient le plus l’attention du public, sans doute à cause des sommes parfois très élevées atteintes par les transactions. Depuis 2000, l’augmentation des produits des ventes a été particulièrement marquante dans le domaine de l’art contemporain : alors qu’en l’an 2000 le marché de l’art contemporain ne pesait que 3 % du marché de l’art global, il en représente aujourd’hui 15 %. Par ailleurs les œuvres qui ont récemment battu les records des enchères ont été très souvent des œuvres contemporaines. Comme l’art contemporain continue à rencontrer des résistances culturelles, les sommes conséquentes payées pour certaines des œuvres qui en relèvent n’en sont que plus « visibles ».
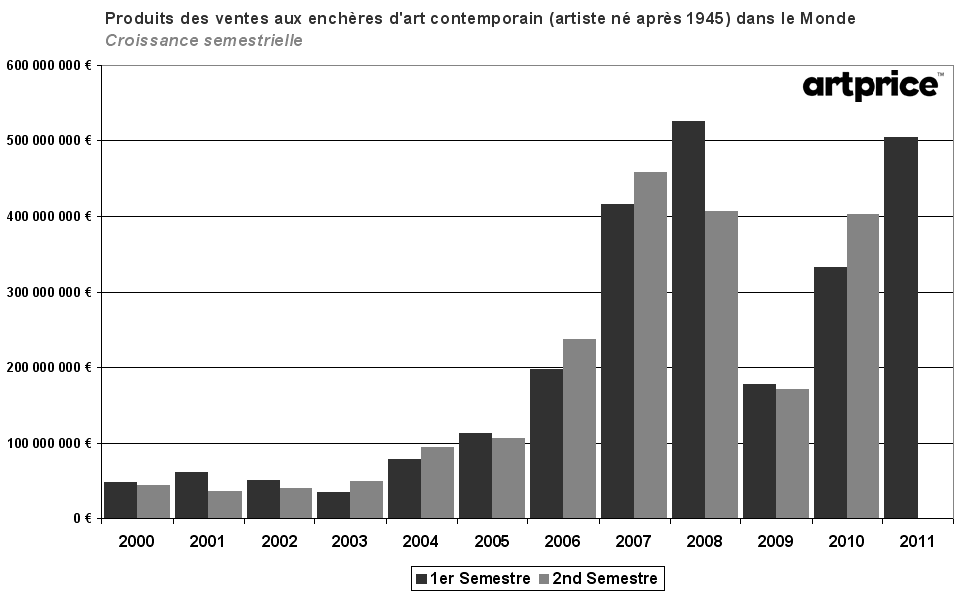
Entre 2000 et 2011 la croissance du produit des ventes d’art contemporain a cru de manière exponentielle, et ce malgré la crise de 2008 : après une chute importante des ventes en 2009 le marché a retrouvé dès le début de 2012 ses performances du premier semestre 2008 (juste avant la crise).
Cependant, en réalité le prix élevé atteint par les œuvres autographiques, qu’elles soient contemporaines ou non, tient essentiellement au fait que l’économie des arts autographiques est un marché de la rareté, caractérisé par une grande asymétrie entre l’offre (restreinte) et la demande (importante). Ce n’est pas une nouveauté liée au marché de l’art moderne, ni au marché de l’art tout court. Dans toutes les cultures, la rareté constitue un levier de valeur extrêmement puissant. Coquillages, pierres précieuses, métaux rares, timbres-poste, prototypes techniques et ainsi de suite ad libitum : tout bien rare est valorisé loin au-delà de son (éventuelle) valeur d’usage.

Pierre Soulages, Peinture, 200 x 162 cm, 14 mars 1960, tableau vendu 9,6 millions d’Euros en 2019.

L’unique exemplaire subsistant du timbre « One Cent Magenta » (Guyane anglaise, 1856), vendu à Londres en 2021 pour l’équivalent de 6,8 millions d’Euros. Contrairement au tableau de Soulages dont le prix ne reflète pas seulement la rareté mais aussi la valeur accordée à l’œuvre, le prix élevé du timbre tient uniquement à sa rareté.
C’est qu’indépendamment de toute question de valeur d’usage, la rareté d’un bien en fait un signe de prestige social. Ceci explique pourquoi les personnes dont le succès social dépend partiellement du prestige dont ils jouissent dans leur communauté recherchent la possession de biens rares. Les œuvres d’arts autographiques remplissent cette condition de rareté à un double titre : elles sont rares parce que chaque œuvre est unique, mais aussi, et en cela elles se distinguent foncièrement d’un timbre-poste ou d’une pierre précieuse, parce que leur création (comme celle de toute autre œuvre d’art) exige une conjonction de talents qui ne se trouve que rarement.
Il n’est donc pas étonnant qu’à notre époque, qui est celle de la marchandisation et financiarisation globales, les arts autographiques aient été investis par la spéculation financière et que les œuvres d’art soient devenus des actifs financiers. Cependant il faut s’entendre sur ce qu’on entend par « spéculation financière ». Il convient d’abord de la distinguer du calcul économique rationnel que fait tout acheteur d’un bien, y compris d’un bien artistique : même un pur amateur d’art, donc une personne ne poursuivant aucune finalité de gain financier, n’achèterait pas une œuvre d’art s’il était certain d’entrée de jeu qu’elle perdra de sa valeur au fil du temps. Il faut aussi distinguer la spéculation de la stratégie marchande classique. Ainsi un marchand d’art qui achète des œuvres pour les revendre espère légitimement le faire avec le plus de profit possible, mais il ne les traite pas pour autant comme des actifs financiers mais comme des biens classiques.
Xavier Greffe a noté que ce qui fait la spécificité de la spéculation financière appliquée aux œuvres d’art, c’est qu’elle considère les œuvres non pas comme des biens classiques mais comme de purs actifs financiers dont on espère une augmentation en capital ou en plus-value : « ce qui compte, ce n’est pas le prix que je paye, mais le gain que je détiens potentiellement et que je réaliserai si je pouvais ou devais le revendre. (…) Je n’achète donc pas un bien mais une espérance de gain. » (Arts et argent, Editions Economica, 2017, p. 208)
Mais est-ce que les œuvres d’art sont des actifs « performants » ? A première vue on pourrait être tenté de donner une réponse positive à la question. Les œuvres d’art sont en effet des biens durables qui ne sont pas détruits par leurs usages : regarder un tableau pendant longtemps et à de nombreuses reprises ne l’abîme pas, alors que conduire une voiture finit par la rendre inutilisable. L’œuvre d’art peut donc facilement devenir une réserve de valeur financière, d’autant plus que, comme Greffe le rappelle, « ses coûts de maintenance sont faibles » (ibid.).
Pourtant, contrairement à ce que suggèrent les quelques cas de croissance exponentielle de certaines œuvres d’art sur des périodes de quelques décennies, à long terme la rentabilité moyenne des œuvres d’art n’est pas très élevée. Dans une étude classique, « Unnatural Value: Or Art Investment as Floating Crap » (The American Economic Review, Vol. 76, No. 2, 1986, p. 10-14) l’économiste américain William J. Baumol a montré que lorsqu’on compare la rentabilité à long terme des œuvres d’art à celle des emprunts d’État (qui sont le seul autre type d’investissement financier qu’on peut suivre sur plusieurs siècles), on constate que leur rendement annuel n’est que de 0,55 % alors que celui des emprunts d’État est de 2 %. Par ailleurs cette moyenne elle-même est trompeuse car, comme les rémunérations des artistes, le taux de rendement des œuvres d’art correspond à une courbe de Pareto, c’est-à-dire qu’il se compose d’un très petit nombre d’œuvres ayant une rentabilité très élevée et d’un très grand nombre d’œuvres ayant une rentabilité minime.
Certes, à partir des années cinquante du XXe siècle le taux de rendement augmente, un mouvement qui, comme on l’a vu, continue aujourd’hui. Mais cette croissance est partiellement en trompe l’œil, du moins dans le domaine de l’art contemporain, dans la mesure où le prix d’une œuvre n’y est garanti généralement que sur une durée de 25-30 ans. Après il a tendance à baisser, notamment parce que le marché de l’art contemporain est très sensible aux effets de mode.
De manière plus générale, du fait de l’inexistence d’outils de prévision fiables, la fixation des prix justes est très difficile dans le cas des œuvres d’art. L’importance du paradigme de la rupture dans le devenir de l’art contemporain rend en fait aléatoire toute prévision au-delà d’une dizaine ou vingtaine d’années, alors que la carrière moyenne d’un artiste actuel s’étend sur au moins quatre décennies. Enfin, pour profiter de l’effet de levier d’un fort rendement il faut investir à un moment où les œuvres n’ont encore que peu de valeur : lorsqu’on entre plus tard dans le circuit d’achat, l’effet de levier n’existe plus.
L’incertitude des rendements à court terme et la rentabilité réduite des investissements à long terme, font du marché de l’art un marché à risque. Il n’est donc pas étonnant que la part des actifs artistiques dans les stratégies de développement des grands investisseurs reste, malgré quelques exceptions célèbres, très faible, correspondant à moins d’un 1 % au niveau mondial (voir Melanie Gerlis, Art as Investment ? A survey of comparative assets, Londres, Lund Humphries Ltd., 2014). D’où sans doute le constat désabusé d’un rapport du Sénat Français daté de 1999 qui notait que le marché de l’art ressemblait beaucoup à une loterie dont tout le monde ne retenait que les (rares) billets gagnants en oubliant l’immense masse des billets perdants.
Partie 3 à suivre.
Les plus populaires
- 26 juin. 2024
- 28 juin. 2024
- 05 juil. 2024
- 04 juil. 2024
ARTICLES
Videos
26 juil. 2024TAPAGE avec Ruth Lorang
Articles
22 juil. 2024Le fabuleux destin de Raphael Tanios
Videos
19 juil. 2024

